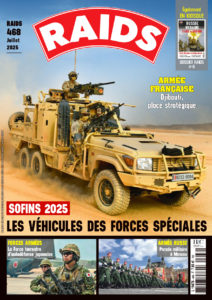En septembre 1996, j’eus la chance de croiser, pour la première fois, les gendarmes du GIGN, lors d’une visite complète du Groupe, deux ans après Marignane. Le souvenir de l’opération était encore frais, comme le fait que le Groupe aurait pu intervenir sur l’Airbus hors de nos frontières, et non à Marignane – ce que beaucoup ont oublié. Un prépositionnement fut même organisé dans ce sens à Palma de Majorque (Espagne). Et dans cette affaire complexe, le rôle de l’escadron parachutiste d’intervention de la gendarmerie nationale (EPIGN) fut éminent, quoique resté discret – encore aujourd’hui –, car il était en Algérie, d’où était parti l’Airbus d’Air France, pour une mission de protection de diplomates français.
En 2002, lors d’un reportage sur la sélection de l’EPIGN, je fus surpris de croiser des gendarmes dotés d’une expérience opérationnelle manifeste, dans l’observation recherche – la plupart des jeunes qui étaient là postulaient pour le groupe d’observation et de recherche (GOR) – mais aussi, et surtout, dans des missions extrêmement risquées de protection de diplomates. Cinq ans plus tard, invité à la cérémonie de dissolution de l’EPIGN, je pus mesurer ce qu’ils avaient vécu : la solennité du moment leur avait fait porter combinaison d’intervention et décorations. Leurs poitrines étaient lourdes de médailles. Et, dans les locaux bientôt promis à réoccupation par des gendarmes mobiles de Satory, figuraient encore quelques souvenirs de ces missions à hauts risques.
Ce double souvenir constitue le point de départ du livre qu’Histoire & Collections a choisi d’éditer sur ces missions extrêmes menées à l’étranger par le GIGN et l’EPIGN. Lors de plusieurs discussions avec de jeunes gendarmes qui venaient d’intégrer le Groupe, je me rendais compte que les entrants connaissaient tous Marignane, mais ils étaient rares à connaître les missions en Somalie, en Libye, en Afghanistan, aux Balkans, en Côte d’Ivoire, tout aussi risquées, auxquelles leurs anciens avaient participé. Sans même parler de plus anciennes encore, en Colombie. Seule la mission en Irak n’était pas étrangère à certains, car elle était encore active, sans pour autant qu’ils en connaissent vraiment les détails.
Ce livre aurait pu leur être dédié. Car par-delà ce besoin essentiel de connaître la mémoire collective, s’ajoute aussi la nécessité de comprendre le présent à la lueur de ces événements, qui sont restés longtemps dans l’ombre, et qui pour certains – comme les missions en Bosnie, une des révélations du livre – sont encore dans l’ombre.
Mesureront-ils que le HK416 qu’ils portent découle en partie de l’engagement en Afghanistan ? Que le nouveau blindé a profité des retex de l’Irak ? Savent-ils qu’un de leurs capitaines (désormais dans le privé où il a créé son activité) a commandé des fantassins de l’armée de terre en Côte d’Ivoire en 2011 dans une situation très dégradée ?
Sans cette expérience des missions à l’étranger, dans l’isolement le plus total et souvent dans des pays en désintégration, voire totalement déstructurés, sans cela, le Groupe de 2017 ne serait pas ce qu’il est.
Comme l’illustre le livre, l’EPIGN puis le Groupe ont mis en œuvre des techniques qui ont permis, au fils des ans et des pays, de préserver la vie des diplomates. Il y avait donc une méthode EPIGN pour cela, qui a été reprise par la force de sécurité protection (FSP) en 2007. Comme le Groupe a peu d’équivalents dans sa mission de contre-terrorisme, il en a peu aussi dans sa capacité d’action à l’étranger, en mobilisant des capacités très limitées, mais rompues à l’exercice. L’exemple du Ponant, en avril 2008, l’a montré : le Groupe a pu, en peu de temps, projeter la bonne capacité nécessaire sur place, alors qu’en parallèle, plusieurs autres opérateurs œuvraient, en métropole, à la libération des otages du voilier de luxe.
Même dans le renseignement humain, le Groupe a été plusieurs fois indispensable. Le cas le plus manifeste est intervenu en Bosnie, dans le cadre de la traque des criminels de guerre, une opération de l’OTAN à laquelle la France a apporté des capacités déterminantes. En coopération avec le 13e régiment de dragons parachutistes (13e RDP), le Groupe s’est en effet chargé de disposer des capteurs permettant de placer sous surveillance plusieurs membres de l’entourage de criminels recherchés par le Tribunal pénal international (TPI). A cette époque, seul le Groupe avait la capacité d’exploitation de données par transmission satellite, mais aussi les capteurs idoines.
Le GIGN a retrouvé le 13e RDP à plusieurs reprises en opérations, notamment en Afghanistan, dans le cadre de la Search Task Unit (STU) qui visait à appuyer l’action de la police afghane (ANP), dans la zone d’opérations de la Task Force La Fayette (TFLF). Le renseignement franco-afghan permettait de localiser des cibles, et le GIGN assurait en quelque sorte la même prestation qu’en France quand il assiste des sections de recherche (SR) pour des interpellations complexes.
En Libye, le Groupe a assuré une manœuvre complète pour ramener, en 2011, une présence diplomatique de proximité, à Benghazi puis à Tripoli. Là aussi, ce n’est pas un sport de masse, cette mission qui a inclus un tarpon, des infiltrations routières, un poser d’assaut… et beaucoup d’ingéniosité. Le Groupe a encore joué un rôle de premier plan lors de l’évacuation des derniers diplomates en 2014 avec, en recueil, les commandos marine et deux frégates restées au large. Comme le révélait le directeur de la gendarmerie lors de son audition à la commission de la Défense, le Groupe s’apprête aussi à se déployer pour soutenir le retour de la diplomatie française en Libye.
En termes d’exposition au danger, la référence principale demeure sans doute Bagdad, longtemps une des villes les plus dangereuses au monde, par la diversité des menaces et leur intensité. Sur un théâtre aussi exposé, les gendarmes de l’EPIGN puis de la FSP ont appris par eux-mêmes, déployant des ressorts d’adaptation pour passer au travers des balles, des IED et d’embuscades complexes.
Un retour d’expérience d’une richesse sans doute trop inexploitée, alors que l’essentiel de ce que ces gendarmes ont connu en Irak fait aujourd’hui les pages principales des bréviaires du terrorisme qui frappe en France depuis 2012.