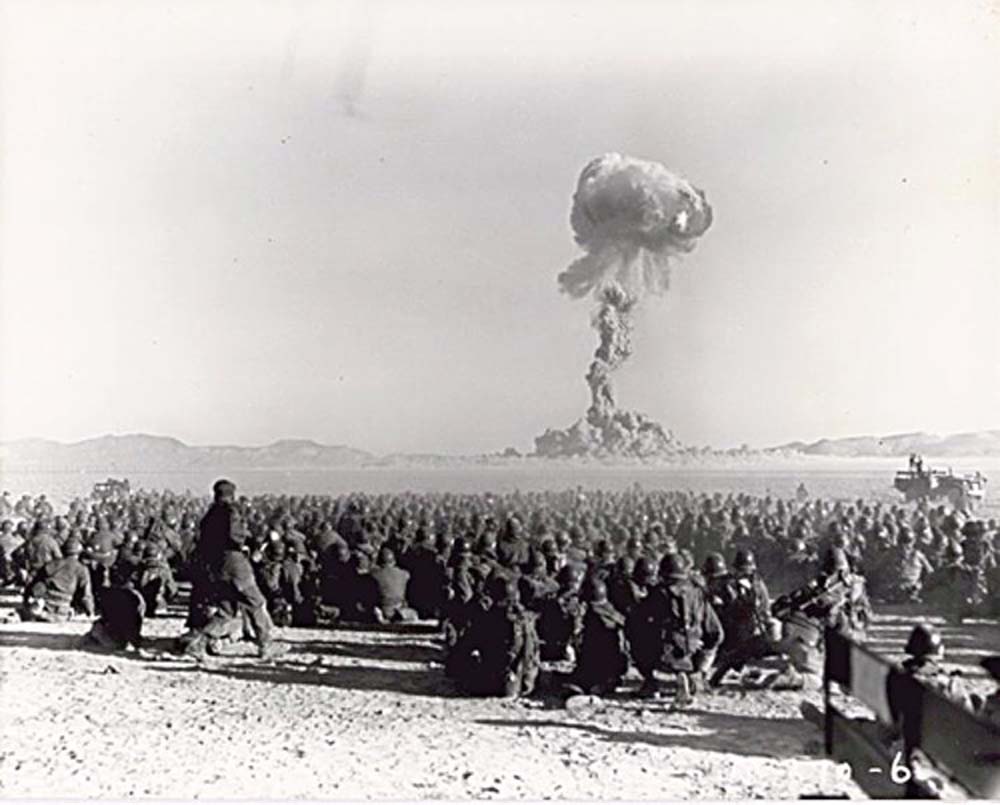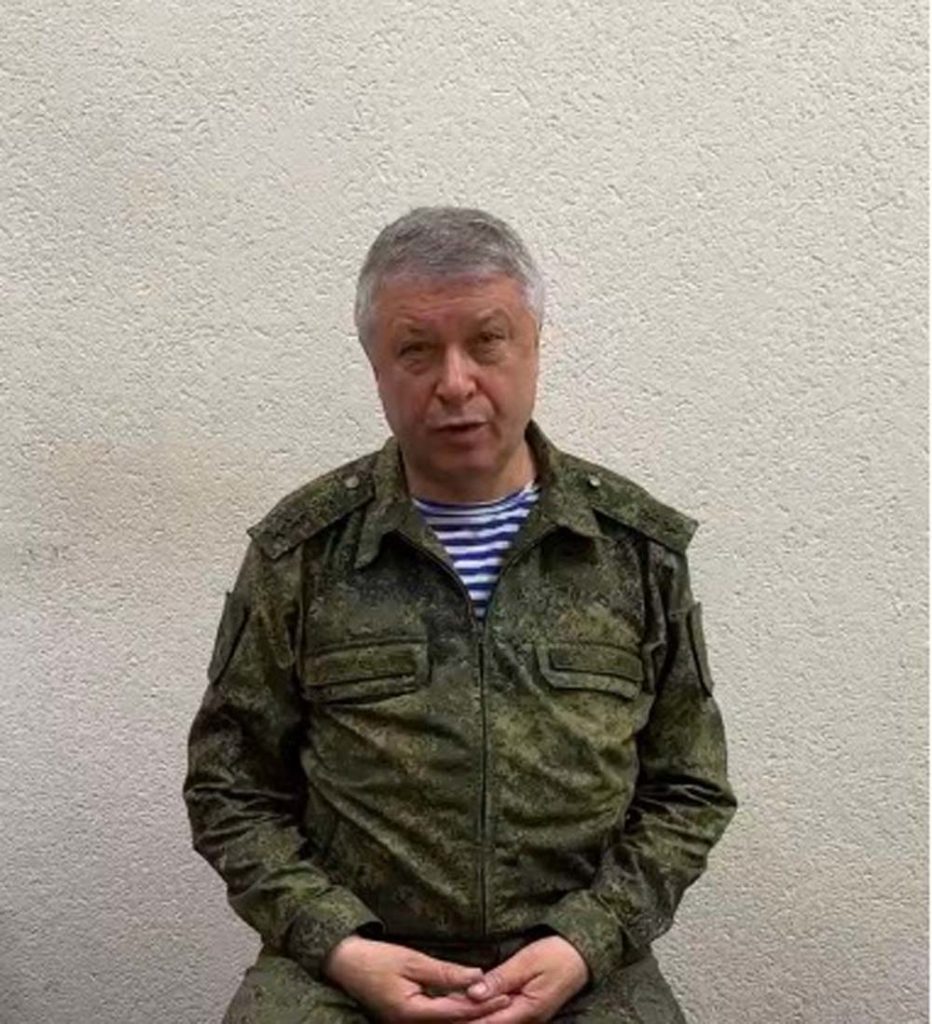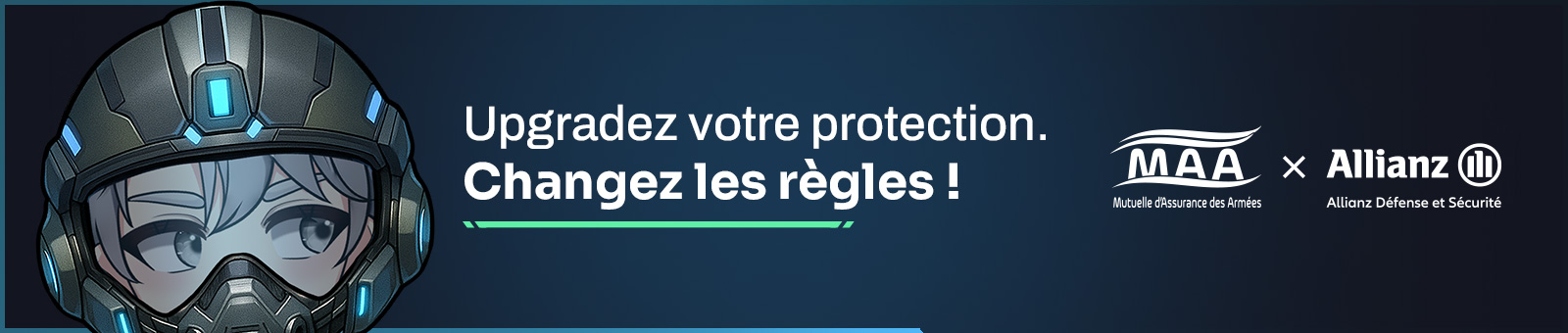Les chaînes d’approvisionnement du trafic de drogues ont alors considérablement évolué, les organisations criminelles profitant du manque d’opportunités économiques pour recruter de nouveaux membres. Surtout, l’insécurité conjuguée aux crises économiques a provoqué une vague migratoire massive que les groupes criminels ont su exploiter à leur avantage.
Remodelage des itinéraires et des chaînes d'approvisionnement du trafic de drogue
En mars 2020, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont fermé leurs frontières à tous les voyages non essentiels avançant qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire pour freiner la propagation de la COVID-19.
La conséquence pour les groupes criminels se livrant au trafic de drogue a été la perturbation considérable les chaînes d’approvisionnement mondiales et l’augmentation de la violence(1).
En effet, au Mexique, les producteurs de drogues synthétiques dépendaient depuis longtemps de produits chimiques précurseurs importés d’Asie – notamment de Chine – pour fabriquer des drogues comme le fentanyl et la méthamphétamine.
Mais face à la raréfaction des importations, les producteurs mexicains ont dû s’adapter.
Au lieu d’utiliser des précurseurs chimiques comme la phénylacétone (P2P) et la méthylamine, ils ont commencé à synthétiser ces composés à partir de produits chimiques moins réglementés et plus facilement disponibles sur place.
Cette évolution a non seulement permis de protéger les producteurs de fentanyl du durcissement des contrôles mondiaux sur les importations de produits chimiques, mais a également augmenté leur résilience face aux aléas des chaînes d’approvisionnement internationales.
En Colombie, la fermeture des frontières a posé aux organisations criminelles le problème inverse : une surabondance de stupéfiants.
En effet, les retards et la hausse des coûts du transport maritime ont créé un goulot d’étranglement laissant aux trafiquants des stocks de drogue prêts à être expédiés.
Avec plus de cocaïne qu’ils ne pouvaient en transporter, les groupes criminels se sont fragmentés et la concurrence s’est intensifiée.
Après la sortie de la pandémie et la reprise de la demande, les trafiquants cherchant à atteindre l’Europe(2) ou les États-Unis ont pu choisir parmi les groupes criminels colombiens avec lesquels collaborer, privilégiant souvent ceux disposant des réseaux logistiques les plus solides, du contrôle territorial le plus important et de l’accès aux voies de trafic les plus accessibles.
Cette concurrence a déclenché de violentes guerres internes creusant les fractures au sein du monde criminel colombien.
Les répercussions de cette lutte de pouvoir sont encore visibles aujourd’hui.
Avec l’entrée en vigueur des confinements nationaux, l’économie équatorienne a été paralysée. De nombreuses entreprises ont fermé et le chômage a explosé.
Les organisations criminelles ont profité du vide laissé par l’État qui avait drastiquement réduit l’aide sociale pour recruter des jeunes chômeurs en leur offrant des revenus conséquents. Mais cela a aussi provoqué un accroissement des violences car la concurrence était rude.
La recrudescence des meurtres de jeunes en est une résultante : aujourd’hui en Équateur, les assassinats de personnes de 19 ans et moins ont augmenté depuis 2020 de plus de 200 %.

Lors du confinement, les forces de sécurité ont recentré leurs efforts sur le respect des mesures de couvre-feu et de distanciation sociale et les opérations de lutte contre la drogue ont chuté. Les priorités de la police ayant changé, le crime organisé a saisi cette opportunité pour se réorganiser et se renforcer.
Dans le même temps, les groupes criminels ont renforcé leur emprise sur le milieu carcéral pour recruter de nouvelles recrues et consolider leur pouvoir.
Les conséquences se font encore sentir aujourd’hui, les prisons équatoriennes restant des épicentres de la violence et du contrôle criminel.
Le trafic de migrants, nouvelle manne pour le monde criminel

Pendant la pandémie, l’émigration en provenance des pays les plus précaires et économiquement les plus en difficulté d’Amérique latine a explosé.
Dans un premier temps, cette mobilisation humaine a été freinée par les confinements et les fermetures de frontières terrestres, notamment entre le Venezuela et la Colombie.
Alors que les canaux officiels se durcissaient, les migrants ont été contraints de se tourner vers des passeurs, notamment ceux du gang vénézuélien « Tren de Aragua. »

Ce groupe a commencé à proposer des forfaits de trafic multi-étapes et multi-pays.
Ensuite, malgré la réouverture des frontières, de nombreux migrants ont continué de faire appel à des passeurs considérant les autorités migratoires et les forces de sécurité vénézuéliennes comme peu fiables.
En Colombie, le nombre de personnes traversant le « bouchon de Darién », la jungle qui relie la Colombie au Panama, a explosé après la pandémie.

Le « Clan du Golfe » (Clan del Golfo) anciennement appelé « Los Urabeños », le « Clan Úsuga » et les « Autodefensas Gaitanistas de Colombia » (AGC) ont considérablement accru leur rôle dans le trafic de migrants face à l’afflux de populations.
Le phénomène s’est accru : en 2021, environ 130.000 personnes ont effectué le voyage et en 2024, ce chiffre a dépassé le demi-million.

L’afflux sans précédent de migrants par « bouchon du Darién » est devenu un enjeu majeur, non seulement pour les groupes criminels locaux, mais aussi pour la politique internationale.
Ainsi, en 2024, la migration est devenue l’un des enjeux les plus pressants de la campagne présidentielle américaine, des milliers de migrants, dont beaucoup se dirigeaient vers les États-Unis, largement aidés par le crime organisé.
Si la migration a considérablement diminué en 2025, le groupe criminel colombien AGC a profité de cette crise pour renforcer son emprise sur la région d’Urabá, dans le nord de la Colombie, où se trouve le « bouchon de Darién. »
Lorsque la COVID-19 a frappé, les États-Unis ont mis en œuvre le « Titre 42 », une mesure de santé publique qui permettait (jusqu’en 2023) l’expulsion de personnes qui avaient séjourné dans un pays où une maladie transmissible était présente…
Mais le Titre 42 a souvent poussé les migrants vers des groupes criminels proposant des services de passeurs, qui ont vu dans l’afflux d’individus vulnérables une occasion d’extorsion, d’enlèvement et d’agression sexuelle.
De plus, comme de nombreux refuges pour migrants ont été contraints de fermer ou de limiter leurs capacités d’accueil, les migrants ont été davantage exposés aux dangers du monde criminel.
Les organisations criminelles mexicaines, notamment le Cartel de Sinaloa, une branche des Zetas, ont renforcé leur contrôle sur les routes migratoires.

Dans les villes frontalières comme Nuevo Laredo, le groupe a multiplié les enlèvements et exigé des rançons pouvant atteindre des milliers de dollars pour leur libération.
L’exploitation de ces migrants, à qui l’on a demandé de rester au Mexique en raison de la fermeture des frontières pendant la pandémie, a considérablement augmenté les profits des groupes criminels mexicains et leur intérêt pour le trafic de migrants comme nouvel élément clé de leurs activités.
La situation sécuritaire en Amérique latine reste toujours extrêmement difficile les groupes criminels – à de rares exceptions près – ayant plus de moyens financiers et humains que les forces de l’ordre.
2. Voir : « Évolution du crime organisé entre le continent américain et l’Europe » du 31 mars 2025.