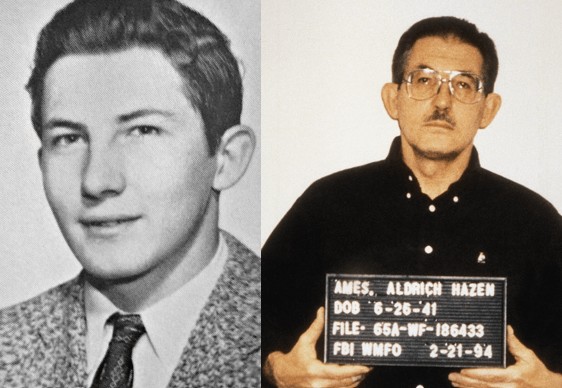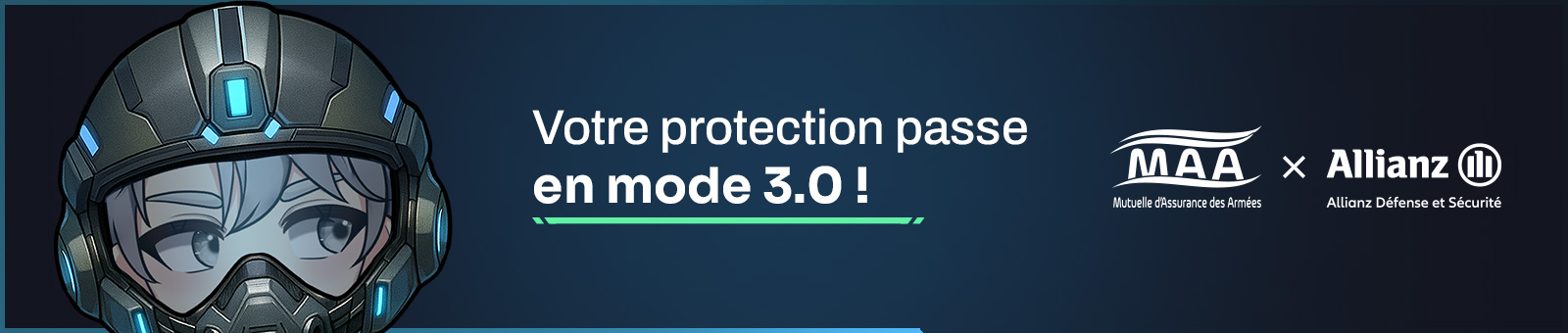Selon la police, les établissements de la Farlède à Toulon, Nanterre en Hauts de Seine, à Aix-Luynes dans les Bouches de Rhône et Valence dans la Drôme ont été impactés.
Des slogans ont été retrouvés sur certains sites portant la signature « DDPF », pour « Défense des droits des prisonniers français ». Les premiers éléments de l’enquête confiée au parquet antiterroriste laisse à penser qu’il s’agit d’une alliance entre des milieux contestataires violents et le banditisme de cité. Ce rapprochement qui serait récent aurait vu le jour à travers les messageries cryptées. Un message a été diffusé le 15 avril disant : « Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l’Homme à l’intérieur des prisons ». « , est-il écrit sur la messagerie Telegram cryptée du groupe « DDPF ». Créé il y a quelques mois, elle totaliserait plus d’un millier d’abonnés avec des messages menaçants : « Surveillants, démissionnez tant que vous le pouvez si vous tenez à vos familles et à vos proches […] les démonstrations de force de ces derniers jours ne sont rien […] sachez que notre mouvement s’étend dans toute la France ».
Les autorités prennent très au sérieux cette menace qui se dévoile et qui est à l’évidence une atteinte à la sécurité de l’État qui est directement visée.
Si les enquêtes en cours des services de police et renseignement devraient apporter des réponses quant –l’identification des membres impliqués dans cette affaire, il est logique de se demander si la sécurité des approches des établissements pénitentiaires comme d’autres sites sensibles ne devrait pas être confiées – au moins momentanément – aux forces armées dans le cadre d’une réquisition ordonnée par les autorités civiles.
Si des demandes politiciennes d’intervention de l’armée dans des quartiers sensible semblaient disproportionnées – et surtout infaisables -, une mission de protection des centres pénitentiaires – comme pour d’autres sites sensibles – est techniquement possible. Bien sûr, il appartient aux autorités politiques conseillées par leurs homologues militaires, de définir précisément les volumes et les règles d’engagement à mettre en œuvre.
Pour le moment, le pouvoir politique veut défendre la France en déployant des forces militaires face à la menace que la Russie fait peser sur l’Est de l’Europe, mais il serait peut-être judicieux de prendre en compte la « menace intérieure immédiate » que tous les services de renseignement connaissent bien. L’opération sentinelle a déjà cette mission.
Le personnels pénitentiaires – comme leurs homologues policiers, gendarmes, pompiers, personnels de santé, etc. – doivent être protégés ; il en va de la bonne marche de l’état de droit et en conséquence, de la sécurité globale des citoyens.
Les points sensibles sont si nombreux que cela distrairait trop d’effectifs de police et de gendarmerie de leurs missions principales d’intervention sur le terrain. L’armée pourrait prendre en charge une partie de cette mission partant qu’elle n’est surtout pas là pour remplir les tâches des personnels mais pour participer à la protection extérieure des établissements.
Quant à la sécurité directe des personnels, elle doit être gérée par différentes mesures policières (protection) et militaires (patrouilles de type Vigipirate.) Certains responsables particulièrement exposés peuvent aussi demander un port d’arme quand une protection rapprochée ne peut leur être accordée – souvent faute de moyens suffisants -. Cela est loin d’être nouveau, des ports d’arme ayant été accordés depuis de nombreuses années à certains personnels pénitentiaires.
Le retour de la Défense opérationnelle du territoire ?


Sur le plan purement technique, on revient sur des temps anciens de « Défense opérationnelle du territoire (DOT) » des années 1970 qu’il faut bien sûr adapter aux réalités actuelles.
Selon le code de la défense, les armées participent : « au maintien de la liberté et de la continuité d’action du Gouvernement, ainsi qu’à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation. ». Parmi ces missions, les armées sont chargées d’« assurer la protection du territoire national et de s’opposer à une ennemi à l’intérieur de celui-ci. »
Pour mémoire, la France avait alors quitté le commandement intégré de l’OTAN et bénéficiait de sa propre force de dissuasion nucléaire. L’ennemi désigné (mais pas expressément nommé pour des raisons de politique intérieure) était le Pacte de Varsovie en général et l’URSS en particulier.
L’objectif du Kremlin était alors le « Grand soir » fondamentalement lié à l’idéologie communiste. Il désignait l’aube d’un jour nouveau qui renverserait non seulement le système capitaliste, mais aussi les normes sociales en vigueur.
Parallèlement à la menace militaire permanente que faisaient peser les armées du Pacte de Varsovie sur l’Europe, le commandement craignait des actions de déstabilisation intérieures conduites par les services secrets (en particulier des actes de sabotage que pouvaient conduire les forces spéciales « spetsnaz ».)
Cette seconde menace était appuyée par des groupuscules terroristes de type anarchiste qui avaient épousé toutes les causes révolutionnaires dont le but final consistait – après avoir tout abattu – à faire connaître « les petits matins qui chantent » aux sociétés occidentales.
Leur inspiration se trouvait déjà dans la cause palestinienne alors soutenue par de nombreux pays arabes dont la Libye mais aussi soutenue indirectement par des services secrets des pays de l’Est.
La DOT avait donc toute son utilité avec un avantage sur la période actuelle : le nombre de personnels (active, appelé, réserve) disponibles.
Pour protéger un site sensible d’envergure moyenne, il faut aligner au moins une compagnie (ce qui fait une section en faction et une en alerte immédiate.) Plus globalement, il faut aussi prévoir une relève constante des effectifs car cette mission très statique pèse sur le moral des personnels.
La réserve peut trouver dans cette mission une motivation particulière car elle est souvent régionale. De plus, les moyens nécessaires peuvent rester relativement basiques en dehors des nouvelles menaces provoquées par les drones et les menaces électroniques.
Nul besoin de véhicules et d’armements très sophistiqués et couteux. Pour mémoire, du temps de la DOT, les unités de réservistes étaient armées de camions GMC, jeeps Willis, fusils MAS 36 et pistolets mitrailleurs MAT 49, mitrailleuses de calibre 50.
Enfin, de manière à tenter d’éviter au maximum tout problème juridique, il conviendrait de définir autour des établissements protégés des zones de sécurité interdites avec la possibilité d’un engagement du feu en dernier recours.
L’exemple de la prison de Spandau à Berlin où était détenu le dernier prisonnier nazi, Rudolf Hess peut servir d’exemple. Il était gardé alternativement par les nations occupantes : Russie, Grande-Bretagne, États-Unis et France.
Le fait de toucher la clôture qui ceinturait l’établissement pénitentiaire pouvait justifier l’ouverture du feu sans sommations. Cela ne posait strictement aucune réticence morale d’autant que les attaquants éventuels étaient des « nostalgiques. »

Bien sûr, cette politique qui est de la responsabilité exclusive du pouvoir régalien de l’État devrait être provisoire le temps que les auteurs de ces menaces soient neutralisés. Mais en France, le provisoire a tendance à durer longtemps d’autant que la menace insurrectionnelle est en train de monter. Les partisans du « grand soir » semblent être de retour même s’ils ne sont pas les mêmes que les aînés de la fin du siècle dernier…